L’année 2024 marque les 10 ans du Service d’assistance aux victimes de traite des êtres humains du CSP Genève. Retour sur cette décennie avec Alain Bolle, directeur du CSP Genève, et Leila Boussemacer, avocate dans le service depuis 2017.
Dans quel contexte est né le Service de traite des êtres humains (TEH) du CSP ?
Alain Bolle (AB) : C’est seulement en 2006 que la Suisse a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette même année, la TEH a été expressément reconnue comme une infraction pénale avec l’introduction de l’article 182 dans le Code pénal suisse.
La prise de conscience de ce phénomène s’est intensifiée avec l’Eurofoot en Suisse, en 2008. On craignait que ce soit l’occasion d’une recrudescence de cas d’exploitation sexuelle. Pour répondre à cette inquiétude, le projet « Liberta » a été mis en place à Genève, incluant l’ouverture d’une ligne téléphonique. Faute de financement, ce projet a pris fin en 2010. Le CSP a alors décidé dans l’urgence de reprendre cette ligne pour continuer à répondre aux potentielles victimes, puis de créer un nouveau service, animé au départ par deux juristes à 60%.
Quels étaient les principaux défis à ce moment ?
Leila Boussemacer (LB) : La traite est un domaine relativement nouveau sur le plan juridique. Il a fallu créer et définir des lignes directrices juridiques et nos critères de travail. Nous nous sommes principalement basés sur la Convention européenne ratifiée par la Suisse en 2013, grâce à laquelle l’exploitation de la force de travail et le prélèvement forcé d’organes, en plus de l’exploitation sexuelle, étaient reconnus comme de la TEH.
Quelles sont les spécificités de cette convention ?
LB : La Convention européenne sur la TEH met l’accent sur la protection des victimes et la prévention. Elle introduit des mesures concrètes en matière d’identification des victimes potentielles, mais aussi des droits, que ce soit de soutien social et matériel ou de permis de séjour pour les victimes étrangères.
Au fil des années, comment le contexte et le service ont-ils évolué ?
AB : Pour le CSP, l’évolution a été marquée en termes de nombre de personnes suivies, en hausse continue, du développement du plaidoyer et d’un travail de sensibilisation. Cela a impliqué un développement de notre expertise et une augmentation des ressources humaines pour faire face à la complexité croissante des dossiers et la hausse des sollicitations. L’impératif d’assurer un suivi social rigoureux est aussi rapidement apparu. L’adjonction d’un poste d’assistante sociale au service a permis de fournir un soutien direct aux victimes et de faciliter leur accompagnement tout au long du processus.
LB : Il est clair que l’augmentation du nombre de victimes est allée de pair avec les efforts de sensibilisation. Par exemple, en 2019 déjà, le CSP a organisé une table ronde sur l’exploitation de la force de travail. Cet événement a thématisé cette forme de traite, encore très peu identifiée. Il a certainement marqué un tournant en contribuant à une hausse significative des cas repérés. Aujourd’hui, les autorités pénales s’intéressent de près à ces situations. Il ne s’agit plus seulement d’affaires civiles, et c’est une évolution positive.
Avec trois autres associations en Suisse, nous avons fondé en 2020 la Plateforme traite, dans le but d’élaborer des principes directeurs et des recommandations, notamment sur le plan juridique et en matière d’exploitation de la force de travail. La création de ce réseau a propulsé le CSP au premier plan de la lutte contre la TEH et permis au service d’agir en étant plus visible sur le plan national.
Aujourd’hui, on peut dire que le CSP est un acteur incontournable dans la lutte contre la TEH à Genève et en Suisse. Par exemple, nous faisons partie du groupe d’experts de la stratégie nationale de lutte contre la TEH, géré par la police fédérale suisse.
AB : Les efforts de plaidoyer et les contributions à la création de politiques de prévention ont permis de faire avancer la cause et de renforcer les dispositifs de soutien aux victimes. Ainsi, en 2019, Genève a adopté une loi spécifique, conférant au Canton la responsabilité de mettre en œuvre des dispositifs de prévention et de lutte contre la traite.
Quels sont les défis actuels et futurs pour votre service ?
LB : Nous sommes confrontés à des récits profondément traumatisants et des histoires terribles, ce qui rend notre travail extrêmement difficile et parfois violent. Derrière les mots « traite des êtres humains » se cachent des réalités tragiques. Nous constituons le dernier rempart entre l’horreur humaine et son invisibilité. Les personnes que nous aidons, souvent marginalisées, pourraient difficilement recevoir un soutien sans notre intervention.
Sur le plan juridique et pratique, nous continuons de faire face à des défis, notamment l’absence de définition claire de la notion d’exploitation de la force de travail dans le Code pénal. La question d’un droit de séjour aux victimes reste aussi au cœur de nos préoccupations. Enfin, un défi majeur est l’absence de dispositifs adéquats pour héberger les hommes victimes de traite.
AB : Nous n’avons effectivement pas de dispositif adéquat pour héberger ces victimes. Il est essentiel de convaincre l’État de l’importance d’offrir un accompagnement résidentiel et/ou ambulatoire pour les victimes de TEH de sexe masculin.





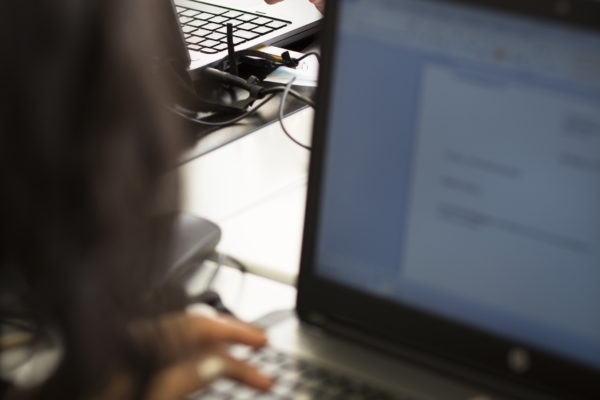
 Prévention de l’endettement des jeunes
Le […]
Prévention de l’endettement des jeunes
Le […] Le Vestiaire social fournit gratuitement des vêtements, […]
Le Vestiaire social fournit gratuitement des vêtements, […] Profitez d'espaces de réunion professionnels au […]
Profitez d'espaces de réunion professionnels au […] Le CSP Genève contribue activement à promouvoir […]
Le CSP Genève contribue activement à promouvoir […] Le CSP fête ses 70 ans […]
Le CSP fête ses 70 ans […] Téléchargez notre Rapport annuel 2024 et […]
Téléchargez notre Rapport annuel 2024 et […] Postes ouverts :
Merci pour votre […]
Postes ouverts :
Merci pour votre […] Les brocantes et boutiques du CSP sont […]
Les brocantes et boutiques du CSP sont […] Offrez une nouvelle vie à vos […]
Offrez une nouvelle vie à vos […] Le projet
Orchestré par la fondation FIDES […]
Le projet
Orchestré par la fondation FIDES […] Vous partagez les valeurs du CSP et […]
Vous partagez les valeurs du CSP et […]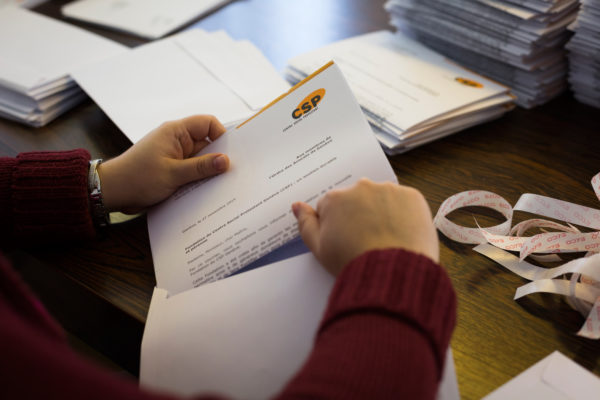 Plusieurs entreprises implantées dans le canton de […]
Plusieurs entreprises implantées dans le canton de […]
 Solidaires aujourd'hui avec les générations […]
Solidaires aujourd'hui avec les générations […] Contribuez à créer un meilleur avenir […]
Contribuez à créer un meilleur avenir […] Alliez plaisir et solidarité
[…]
Alliez plaisir et solidarité
[…] Les éditions numériques gratuites
Le Service […]
Les éditions numériques gratuites
Le Service […] Vous trouverez ici toutes les communications émanant […]
Vous trouverez ici toutes les communications émanant […] Le CSP de Genève publie quatre fois […]
Le CSP de Genève publie quatre fois […]